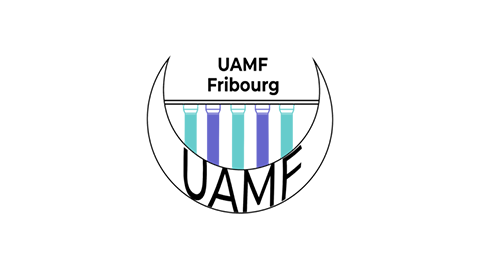Document de position: L’égalité n’est-elle possible qu’en l’absence de voile?
La FOIS et les 16 fédérations faîtières qui lui sont affiliées observent avec une vive inquiétude le débat actuellement grotesque autour du voile.
Certains acteurs politiques nourris de ressentiments négatifs, des journalistes s’appuyant sur des prétendues “révélations”, ou encore des lecteurs exprimant des préjugés persistants, soulignent inlassablement l’idée que la vie musulmane serait incompatible avec la Suisse ou l’Europe.
Concernant les enseignantes portant le voile :
Comment peut-on défendre l’égalité des femmes et, en même temps, restreindre l’accès des femmes musulmanes à la vie publique? À y regarder de plus près, on constate qu’il s’agit d’une compréhension réductrice de la liberté religieuse, qui entrave l’intégration et empêche de manière artificielle la diversité au sein des écoles.
Certes, l’État ne doit favoriser aucune religion. Mais la neutralité ne signifie pas l’invisibilisation, elle signifie l’égalité de traitement. Dans ce débat, le cœur même de la neutralité est trop souvent manqué, ce qui conduit à une discrimination orientée dans un seul sens.
Une communauté religieuse est pleinement intégrée lorsqu’une participation égale à toutes les professions est rendue possible. Les enseignantes concernées rappellent constamment que le port du voile relève d’une conviction de vie et ne varie pas selon l’heure ou le contexte, en dehors du cadre privé. Une approche fondée sur l’interdiction n’est donc pas inclusive, mais excluante.
L’argument souvent avancé selon lequel des élèves pourraient se sentir “sous pression” en raison du voile de leur enseignante ne repose sur aucune base scientifique. Il est au contraire probable que les enfants apprennent par la diversité et les rencontres dans leur environnement scolaire.
L’égalité entre femmes et hommes ne peut être définie uniquement à travers le voile. L’autodétermination et l’égalité se construisent par la rencontre sur un pied d’égalité, et non par la restriction. De plus, les enseignantes sont engagées non pas en fonction d’un vêtement, mais sur la base de leurs compétences pédagogiques et professionnelles. Au final, une image biaisée se crée, alimentant des peurs généralisées et renforçant la méfiance au lieu de préserver la neutralité promise.
La neutralité de l’État ne signifie pas bannir la religion de l’espace public, mais traiter toutes les appartenances religieuses de manière égale. Les enfants d’aujourd’hui devraient apprendre qu’il importe peu que leur enseignante porte un voile, une kippa, une croix ou aucun signe religieux, tant qu’elle enseigne avec compétence et respect. Tout le reste revient à combattre des menaces imaginaires – et représente une occasion manquée pour une société réellement ouverte, ainsi que pour le recrutement de professionnelles qualifiées.
Concernant les interdictions visant les élèves et l’espace public :
Comment les partisans d’une interdiction peuvent-ils se réclamer de la Constitution suisse, tout en portant simultanément atteinte aux droits fondamentaux de la population?
Au cœur de ce débat se trouve une attitude clairement discriminatoire, qui complique la participation des femmes musulmanes à la société plutôt que de la faciliter.
Le fait que certaines jeunes filles portent un voile à la mosquée n’a rien d’une « révélation » : il s’agit d’un apprentissage naturel, approprié à leur âge, au sein de leur environnement familial et communautaire.
Nous rappelons ici qu’il n’existe aucune contrainte en matière de foi. Le port du voile n’a de sens que s’il résulte d’une conviction personnelle. C’est une décision entièrement individuelle, qui doit être respectée, qu’elle aille dans un sens ou dans l’autre.
Il est également important de préciser que, dans l’Islam, le port du voile est associé à la puberté. Lorsqu’il est question de très jeunes enfants, il ne s’agit pas d’une obligation religieuse.
Il convient également de souligner que les prescriptions religieuses ne concernent pas uniquement les femmes. Les hommes suivent eux aussi des règles vestimentaires, éthiques et liées à leur mode de vie. Centrer le débat exclusivement sur le voile féminin donne une image incomplète de la réalité religieuse vécue par toutes et tous, et renforce une séparation artificielle entre les genres.
Dans nos fédérations, l’égalité entre femmes et hommes est encouragée et soutenue de manière constante, malgré les accusations récurrentes.
En conclusion, il reste à espérer que les générations futures accepteront les différences vestimentaires et les modes de vie au travail ou dans les relations sociales comme une composante naturelle d’une société diversifiée, tant que cela ne nuit à personne et que tous peuvent cohabiter pacifiquement.
En collaboration avec